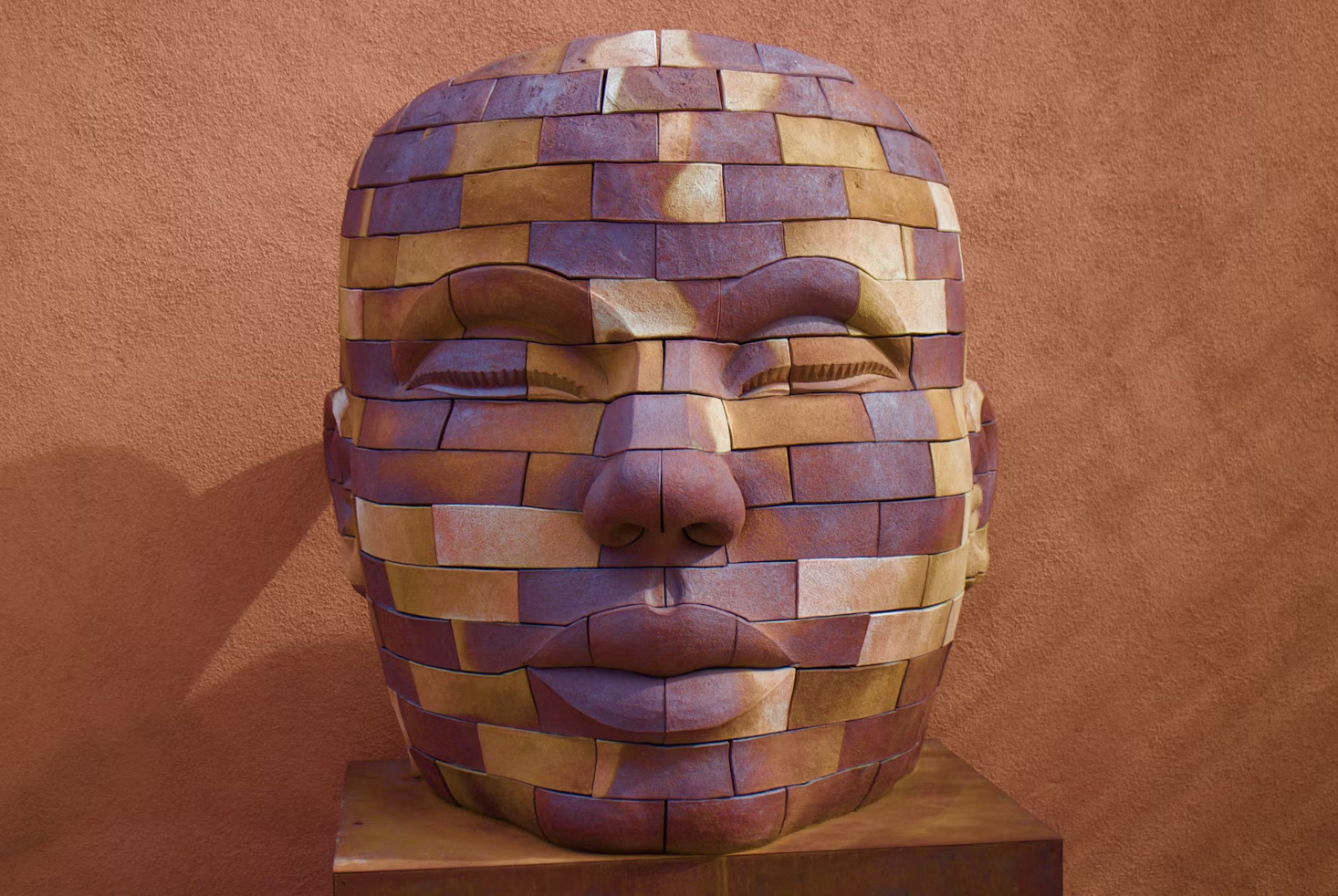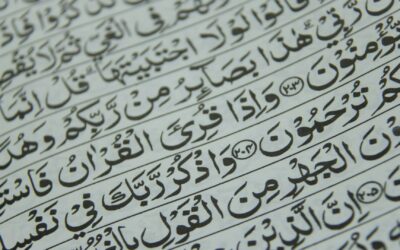Symbole d’élégance et de tradition, la « Keswa el Kebira » – littéralement « la grande robe » – incarne toute l’essence des mariages juifs marocains. Héritée de l’Andalousie médiévale, cette tenue nuptiale s’est imposée comme un vêtement d’apparat d’une valeur inestimable, autant pour sa beauté que pour la richesse de son symbolisme. Tissée de fils d’or et empreinte de significations spirituelles profondes, elle se transmet comme un véritable vecteur de mémoire et de culture. Aujourd’hui encore, la Keswa el Kebira demeure l’un des piliers des célébrations nuptiales, notamment lors de la nuit du henné.
L’héritage andalou : une tradition solidement ancrée au Maroc
Les racines de la Keswa el Kebira remontent à l’Espagne du XVe siècle. À cette époque, au cœur des fastueuses cours des rois musulmans, des artisans juifs réalisaient de somptueuses robes brodées de fils d’or. L’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 entraîna la dispersion de ce savoir-faire, qui trouva refuge au Maroc, et plus particulièrement à Fès, ville réputée pour ses maîtres brodeurs.
Devenue un vêtement traditionnel incontournable, la Keswa el Kebira – appelée également « traje de berberisca » en judéo-espagnol – se portait lors des mariages pour affirmer le statut social et l’appartenance culturelle de la mariée. Souvent offerte en dot, elle se transmettait de génération en génération comme un véritable trésor familial, incarnant à la fois l’identité et la mémoire judéo-marocaine.
L’opulence et les significations profondes de la Keswa el Kebira
La Keswa el Kebira se distingue par sa somptuosité et son raffinement. Elle se compose de plusieurs pièces richement ornées, chacune porteuse d’une valeur symbolique. Au centre de la tenue trône le « ghonbaj » (ou « gombaz »), corset ajusté en velours, brodé de fils d’or et rehaussé de paillettes, porté sur un plastron (« ktef ») assorti. Les manches (« kmam »), légères et aériennes, réalisées en mousseline ou en soie, se fixent sous les épaules, apportant fluidité et élégance à l’ensemble.
La jupe, appelée « zeltita » (ou « jeltita »), constitue une autre pièce maîtresse. En velours, elle s’enroule autour de la taille et se pare de galons d’or disposés en bandes horizontales. Leur nombre varie selon les traditions, mais atteint souvent 22 – en référence aux 22 lettres de l’alphabet hébraïque et de la Torah. Dans certaines versions, il peut même monter à 26, correspondant à la valeur numérique du nom divin selon la guématria.
Pour parfaire l’ensemble, une large ceinture (« hzam »), souvent en brocart de soie dorée, est enroulée plusieurs fois autour des hanches afin de maintenir la jupe. Aux pieds, la mariée porte des babouches finement brodées, tandis que sa tête est ornée d’une coiffe somptueuse (« sfifa » ou « swalef ») décorée de perles, de pièces d’or et de pierres précieuses. Chacun de ces éléments recèle une signification particulière, tout comme les motifs brodés : pampres de vigne et grappes de raisin symbolisant l’abondance et la prospérité, spirales et roues évoquant le cycle de la vie et l’éternité.
Les couleurs du velours varient selon les régions : vert émeraude ou bleu nuit dans les cités du centre du Maroc, rouge grenat ou pourpre dans le nord, notamment à Tétouan et Tanger.
Un vêtement au cœur des rituels nuptiaux
La Keswa el Kebira n’est pas qu’une robe : elle occupe une place centrale dans le rituel nuptial judéo-marocain. Si elle n’est pas portée sous la « houppa » – l’autel du mariage religieux –, elle est incontournable lors des festivités pré-nuptiales, en particulier pendant la nuit du henné (« noche de Berberisca » dans le nord du pays).
Ce moment festif, rythmé par des chants judéo-espagnols et une atmosphère joyeuse, voit la mariée, drapée d’or et de traditions, recevoir les bénédictions de ses proches. Son entrée, éclatante de beauté, scelle l’alliance entre deux familles et perpétue la continuité des coutumes. Souvent, mères et grands-mères revêtent elles aussi leur propre Keswa el Kebira, créant ainsi un lien tangible entre les générations.
Autrefois, une même robe pouvait traverser les décennies, portée par plusieurs femmes d’une même famille lors d’événements majeurs – mariages, circoncisions, bar-mitsva ou fêtes religieuses – renforçant ainsi sa valeur symbolique.
Transmission d’un patrimoine vivant
Si l’usage de la Keswa el Kebira s’est raréfié au fil du temps, elle demeure un symbole vibrant de l’identité judéo-marocaine. La production de ces robes a fortement décliné à partir des années 1950-1960, conséquence de l’exode massif des Juifs du Maroc et de l’essor des robes de mariée occidentales. Néanmoins, certaines mariées issues de familles marocaines continuent de la porter, notamment lors de la cérémonie du henné.
Les savoir-faire ancestraux – broderie d’or, tissage du velours – ont peu à peu décliné avec l’industrialisation et la mondialisation. Les Keswa el Kebira authentiques sont aujourd’hui considérées comme des objets de collection et des trésors familiaux, souvent conservés par des descendants installés en Israël, en France ou au Canada.
Chaque fois qu’une mariée de la diaspora s’enveloppe dans cette robe somptueuse, elle fait revivre l’histoire et la mémoire collective de la communauté judéo-marocaine. Plus qu’un simple vêtement, la Keswa el Kebira incarne l’âme d’un patrimoine biculturel, tissant ensemble héritage hispano-mauresque et tradition juive, pour continuer de rayonner à travers les générations.